L'aire arabe, à l'épreuve de la mondialisation
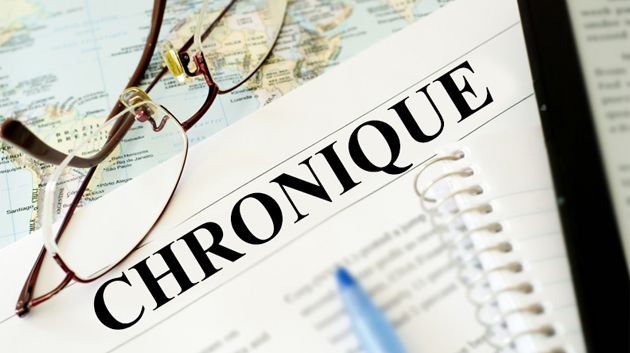
Pr. Khalifa Chater
Cette question a été étudiée, dans le cadre du colloque : «Enjeux et défis de la mondialisation pour les pays en développement », organisé par le Forum de l'Académie politique,
en collaboration avec la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung (Gammarth, 21-22 octobre 2O16). Problématique formulée par le professeur Hasan Annabi : «la mondialisation peut être porteuse d’un grand nombre d’opportunités pour les pays en développement et ceci grâce, entre autres, à l’accès facile au marché des capitaux, à l’information et aux nouvelles technologies. Elle favorise le rapprochement des peuples grâce aux échanges culturels, aux activités de loisirs et aux élans de solidarité en cas de catastrophes ou de crises. Mais, autant la mondialisation offre des promesses de croissance et de contacts fructueux, autant elle accroît les risques d’instabilité et de marginalisation».
De nombreux experts participèrent à ce colloque et confrontèrent leurs visions, sur la question. Au préalable, Ils définirent la mondialisation, au-delà de la définition sommaire du dictionnaire Larousse : “la Mondialisation est l'interaction généralisée entre les différentes parties de l'humanité”. Il s'agirait d'un processus “d'uniformisation, des manières de penser et d'agir et (de velléités) d'une uniformisation des dispositifs institutionnels ” (Mohamed Salah Bachta). En tant que telle, la mondialisation est appréhendée et appréciée : Said Aidi, ancien ministre s'interroge : “ s'agit-il d'un miroir aux alouettes ? ”. Afif Chelbi, ancien ministre de l'industrie et des technologies évoque les différentes visions : “une mondialisation économique et non politique ?”, “une promesse d'un monde meilleur pour les futures générations ?”, un processus “exclusivement libérale ?”. Prenant acte de son caractère irréversible, Afif Chelbi, étudie sa dimension économique, dans le cas tunisien et estime qu'on doit "donner la bonne dimension, à l'expression régionale". Il rappelle que le Maghreb ne peut être une alternative à la mondialisation et exprime le souhait de la conforter, sinon d'atténuer ses effets unilatéraux par "un modèle de développement plus équilibré".
Les enjeux et les défis de la mondialisation – que certains préfèrent appeler globalisation, selon le terme consacré dans les pays anglo-saxons, ont été étudiés dans les pays du Maghreb, en Jordanie et en Syrie. Vu l'exécuté du marché tunisien, Afif Chelbi a fait valoir la nécessité d'ouverture au marché international, y compris pour les entreprises crées dans les régions rurales de l'intérieur. Il remarque qu'il faudrait privilégier une compétition hors prix, de qualité à la compétition prix. Abdelmajid Hamrouni, ancien consultant et expert à la FAO a analysé les effets de la mondialisation, sur la biodiversité végétale, en Tunisie : “Manipulées par les généticiens, dit-il, nos ressources agricoles nous sont maintenant, retournés sous forme de produits hybrides "jetables" après une première mise en culture ”. Houcine Jaidi a étudié les effets de la mondialisation sur le patrimoine tunisien, y compris le patrimoine non matérielle. Abderrazak El Hiri a montré que les pouvoirs publics au Maroc, ont fait de l'ouverture sur l'extérieur, un choix stratégique. “Les clefs de succès de cette insertion, dit-il, résident dans l'approfondissement des réformes visant l'amélioration des diverses dimensions de la compétition”. Khaled Bouhend a étudié les conséquences du développement du réseaux de tramways, en Algérie, sur l'accueuil de la mondialisation. D'autre part, le colloque a étudié le cas de la Jordanie (Ahmed Schogran, Managing Director). Zaki Mehchy, cofondateur et membre du centre syrien de la politique de recherche a traité le "développement inverse et son rôle dans la crise de Syrie", mettant en valeur, la "problématique du mauvais voisinage" et des rapports des frères ennemis.
Une séance a été consacrée à l'interaction de la mondialisation et du terrorisme, dans les différents pays de la Zone MENA (Machrek-Maghreb). Deux séances ont été réservées à l'examen des enjeux et défis stratégiques de la mondialisation “Peut-on alors parler, dans le cas de l'aire arabe, s'interroge Khalifa Chater, d'une mondialisation instrumentale et d'une antimondialisation des objectifs, conjuguant ainsi la modernité technologique et les valeurs antimodernes?” Hatim Ben Salem, Directeur de l'Institut des Etudes stratégiques, a résumé les enjeux géopolitiques de la mondialisation. Il a montré la nécessité des réformes de l'enseignement. Jean Claude Völkel a étudié les transformations de la région MENA entre les visions politiques et les nécessités économiques. Peut-on parler, dit-il, dune "insurmontable contradiction" ?
D'intéressants débats ont enrichi le colloque et permis de formuler des recommandations, en faveur de la prise en compte des enjeux et du défi de la mondialisation.












