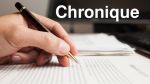Les embûches du cheminement de la Tunisie vers la démocratie

Par Mansour Mhenni
La Tunisie a réussi, aux yeux du monde entier, à faire l’exception dans ce qu’il a été convenu d’appeler « le printemps arabe », avant que celui-ci ne s’avère être un hiver des plus rigoureux dans la plupart des pays concernés.
Il faut reconnaître qu’à plusieurs moments, le processus a paru risqué et le cheminement vers la démocratie difficile et truffé d’embûches. Des obstacles intrinsèques et des immiscions étrangères ont perturbé la donne révolutionnaire ; mais la plupart des Tunisiens, forts d’un grand héritage civilisationnel et d’un sens séculaire de l’Etat, sont restés fixés sur leur besoin et leur ambition de ne pas rater, cette fois encore, une autre chance de mettre justement le cap sur la démocratie et de franchir le cap de la transition avec le moins de dégâts possibles. La Tunisie a réussi, n’en déplaise aux pêcheurs en eaux troubles, mais le processus reste fragile malgré le succès de la transition politique (Constitution et élections libres), et cela pour plusieurs raisons.
D’abord l’élan révolutionnaire, à son déclenchement en Tunisie, au lieu de se tourner rapidement vers la construction de l’avenir de la société sur la base d’une rationalité généralisée et d’une passion contrôlée, s’est fixé excessivement, voire exclusivement, sur le passé jusqu’à l’obsession maladive qui privilégie la culpabilisation d’autrui aux dépens de la responsabilité de soi. Du coup, on reverse sur Ben Ali et même Bourguiba, non seulement les défaillances du passé, ce qui peut se comprendre, mais les erreurs du présent aussi.
C’est pourquoi aujourd’hui, la solution intelligente et raisonnable consisterait, probablement, en une mobilisation unanime pour le travail rentable et assidu, dans une conscience citoyenne toujours en éveil pour se dresser contre tout ce qui pourrait remettre en danger les acquis du passé, proche et lointain, et le succès du présent.
La seconde raison serait celle d’un détournement du centre d’intérêt, par les gouvernements postrévolutionnaires, vers des conflits idéologiques qui n’avaient été pour rien dans l’événement fondateur d’un espoir dans une république, celui de janvier 2011. Du coup, c’est la nature même de la société tunisienne qu’on a cherché à travestir, contre l’Histoire et la logique du progrès, au profit de modèles sociétaux anachroniques. Au résultat, le débat politique a failli quitter les rails du processus civil pour se fourrer sur la piste dogmatique d’un spiritualisme politique, qui n’aurait d’autre issue que la violence et l’exclusion, longtemps reprochés aux régimes précédents.
Cette violence séparatiste s’est nourrie d’un certain laxisme et d’une indifférence caractérisée à l’étendue de ses racines, d’une inattention irresponsable à ses raisons manipulatrices, voire même d’un manque de vigilance à l’égard de ses complices mal intentionnés. Aujourd’hui, les braises éparpillées de cette violence continuent de menacer la démocratie naissante, essayant cyniquement de se dresser franchement contre une démocratie à laquelle ils n’avaient adhérer que pour mieux l’atteindre dans son corps sain et y laisser des infirmités congénitales.
Ironie du sort, hier la dictature a justifié ses abus au nom d’une perception dite intégrale des droits de l’homme, aujourd’hui on cherche à étouffer dans l’œuf l’oiselet de la liberté démocratique au nom du droit à la liberté. Drôle de confusion, avec ces concepts qui changent de sens en changeant de bouche et de valeurs relatives qui préfèrent s’entretuer plutôt que de converser !
On pourrait prolonger la liste de ces facteurs de ralentissement, voire même de compromission du processus démocratique tunisien, cependant, le temps ne nous semble pas celui de l’échange des accusations et des dénigrements. Il nous paraît urgent de faire régner l’esprit de conversation dans cette société qui a tous les atouts pour s’y adapter. Urgent aussi de faire converger les bonnes intentions, au-delà des divergences, de façon à faire des différences un ciment à même de souder le corps social et de réhabiliter le sens de l’Etat, dans un élan de générosité laborieuse et de solidarité fructueuse, dans le respect réciproque et dans le patriotisme inaliénable.
Comme cette culture aura besoin de temps pour s’imposer, il importe que les responsables de l’ordre, désormais soumis à la seule exigence de la loi, continuent d’aider à encadrer les citoyens dans leur marche vers la démocratie, n’hésitant pas au besoin à remettre dans les rangs ceux qui chercheraient à la détourner de l’itinéraire qui se doit, c’est-à-dire veillant à sauvegarder le vivre-ensemble civilisé, juste cela, rien de moins et rien de plus.