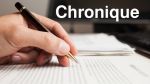Notre histoire et le récit d’Elyssa

Je crois avoir toujours plaidé pour une rationalité réceptive et hospitalière de l’échange entre les personnes, les cultures et les populations, de la façon qui se méfie de la rigidité idéologique et qui relativise les vérités respectives. Je ne sais jusqu’à quel point j’ai réussi à être ainsi, mais je sais que c’est ce qui me travaille toujours et l’aventure où je m’étais lancé en initiant le concept de la Nouvelle Brachylogie est en étroite relation avec cette vision des choses. C’est avec cet esprit que je me permets ici de converser, ouvertement pour un élargissement de l’échange, avec un ami dont je respecte la culture et l’intelligence mais qui me paraît se laisser aller, parfois, à un acharnement idéologique nuisant aux nobles objectifs auxquels il dit aspirer, en partage.
C’est un statut sur sa page qui m’a interpellé, dont voici la traduction approximative : « Le mythe du mensonge et de la fausseté est tombé : pas de princesse de Tyr, pas de peau de taureau, pas de navires phéniciens qui coulent, car Carthage est tunisienne d'origine et de semence, indigène de la terre et des racines. » Ce commentaire s’appuie sur une étude, réalisée par Stanford University (California, USA) « en collaboration par des départements de Stanford et plusieurs universités européennes ainsi que l’Institut National du Patrimoine Tunisien », et publiée sous le titre (A Genetic History of Continuity and Mobility in the Iron Age Central Mediterranean), repris chez nous en français par Kapitalis et Webmanagercenter : « Identité carthaginoise : quand la génétique révèle un empire enraciné en Afrique du Nord ». L’étude en question vaut bien toute la valeur scientifique qui lui revient, mais ne me semble pas justifier les déductions hâtives et chargées d’animosité qui annoncent la couleur d’une passion conflictuelle. D’ailleurs l’article scientifique est bien inscrit, lui, dans la relativisation des affirmations, pourtant considérées comme scientifiques. A preuve cette précision introductive marquée par la précaution et la relativisation : « une vision qui, si elle n’est pas entièrement fausse, reste cependant bien réductrice ».
En effet, mythe ou réalité, le récit d’Elyssa reste un fondement important de l’histoire de Carthage et, à son propos, il n’aurait pas existé réellement qu’il était bon de le créer. En effet ses prolongements culturels, civilisationnels, et philosophiques même, sont d’une profondeur et d’une richesse qui a inspiré, près de trois millénaires déjà, non seulement Carthage-Tunisie mais le monde entier depuis l’Europe jusqu’à l’Amérique. Même avec le récit d’Elyssa comme une réalité historique, d’ailleurs jamais démentie mais tout juste relativisée, on ne saurait prétendre que ses compagnons de voyage constitueraient un État ; c’est plutôt la valeur de la mixité de populations et même de leur métissage qui prévaut comme un facteur déterminant de la population du monde, dans son pluralisme et sa diversité inaliénables.
Ainsi, au terme de ce clin d’œil conversationnel à l’intention de mon ami Mustapha Attia, mais ouvert à tous les intéressés, je renvoie mon ami à un autre statut qu’il a publié sur sa page et dans lequel il se demande s’il n’est pas en train de prêcher dans le désert : « Wagner, avec sa musique, a brisé toutes les chaînes qui emprisonnaient les aspirations humaines et enchaînaient l’esprit. Nietzsche, au contraire, a renversé la situation du moralisme face aux hypocrites, aux opportunistes, aux traîtres et à ceux qui ont vendu leur conscience. Tous deux ont ouvert la voie à l’autorité de l’amour et de la raison. Là où l’amour abonde, l’oppression recule, et là où l’oppression domine, l’amour dépérit. N’avons-nous pas besoin aujourd’hui d’une approche wagnérienne et nietzschéenne pour sortir de l’impasse dans laquelle nous sommes tombés ? Ou est-ce que je laboure la mer ? ». Justement, à bien repenser le cas de Wagner et de Nietzsche, ce qui ne veut pas dire les suivre à la lettre et au pas, on se rend compte qu’il n’y a pas de pensée unique à même de changer le monde, il y a une pensée plurielle qui s’enrichit de sa diversité et surtout de l’interrogation permanente qui la relativise au profit de l’hospitalité aux idées d’autrui. Il y a l’acceptation du récit d’Elyssa, de Sophonisbe et de la Femme d’Hasdrubal, avec l’idée de toujours les interroger avec d’autres récits dont la réalité incontestable ne diminuerait pas la dimension mythique qu’ils peuvent générer : Oqba, Taraq Ibn Zied, Ibn Rochd, Ibn Hamdis Essiqelli, etc.
Conversons donc avec notre Histoire, dans la sérénité et l’humilité de l’esprit de conversation !