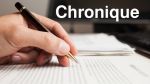Poncer notre mémoire pour repenser la guerre

Par Mansour M’henni
Aujourd’hui 15 octobre 2025, la Tunisie commémore la fête de l’évacuation comme un signe d’épuration du territoire national des dernières manifestations de la colonisation française en Tunisie.
Cette symbolique n’est certes pas unanimement ainsi perçue, jusqu’à aujourd’hui même pour certains, soulignant la relativité de l’évaluation des événements les plus importants de l’histoire des peuples et des rapports entre les nations.
Il n’est pas de notre propos de nous attarder plus longuement sur ces détails qu’on reprend régulièrement, à chaque commémoration, chacun pour ce qui conforte son idéologie politique et sa perception du rôle de l’histoire dans une meilleure intelligence de l’avenir. Je voudrais cependant souligner l’intérêt qu’on pourrait trouver dans une rencontre académique internationale organisée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse du 16 au 18 octobre 2025, avec le parrainage de l’Université de Sousse, par le Laboratoire de Recherche Ecole et Littératures en partenariat avec le Collectif CURA (Culture-Recherche-Université-Associations), une instance informelle de coordination et de coopération initiée par les trois associations (ACAM-Brachylogia-QCA).
Cette manifestation scientifique, baptisée « Rencontres de l’Intelligence Conversationnelle et ses Expressions Civilisationnelles » en est à sa seconde édition (RICEC – 2) inscrite sous le titre : « La guerre et la paix dans la pensée, la littérature et les arts », un titre qu’on imagine bien faisant l’effet d’une précaution à prendre quant à toute exploitation politique de l’événement académique.
Cependant, s’en empêchera-t-on à la fin, surtout que l’événement coïncide avec un autre d’une portée internationale, touchant à une cause figurant incontestablement en tête de liste des grands malheurs et des intolérables injustices que traine encore le monde d’aujourd’hui dans sa vision exhibée d’une prétendue humanisation incontestable de la gestion des relations internationales.
En effet, après une guerre de quasi-extermination conduite contre la petite portion de terre que défendaient héroïquement une population aux moyens précaires contre la plus grande puissance militaire du monde d’aujourd’hui, et après une manifestation de soutien à cette juste lutte défensive menée par la population civile mondiale concrétisée par la « Flottille du Soumoud », les principaux intervenants ont conclu un accord de paix scellant « la libération de Gaza », tout en gardant dans l’implicite de leurs démarches les risques de resurgissement des hostilités, pour le moindre motif qui ne correspondrait pas aux intentions non déclarées mais facilement imaginables des Forces ayant amené « le processus de paix » vers les Accords de Charm-el-Cheikh.
Le déroulement des travaux du colloque de Sousse permettra sans doute de saisir la difficile séparation de ce qui est de l’ordre de l’analyse littéraire et de la pratique du discours d’un côté, et de ce qui relève de la politique politicienne à des moments clés de la gestion des conflits internationaux. On comprendra alors que les littératures sont toujours, d’une manière ou d’une autre, une façon de voir la vie évoluer vers des idéaux recherchés et difficiles à atteindre.
L’école serait-elle sur la voie de la quête sincère et partagée de ces idéaux, plus même que la gouvernance internationale ? Serait-elle surtout le foyer inaltérable des hautes valeurs d’une humanité intelligente ? Grâce aux littératures et aux arts ? Rappelons que cette manifestation est organisée aussi dans le cadre des récherches et des études brachylogiques oeuvrant pour l’esprit de conversation.
Osons y croire et faisons ce qu’il faut, comme disait A. Camus, pour qu’il en soit ainsi, à chaque fois que nous pensons et repensons la guerre et la paix, en ponçant notre mémoire et notre Histoire, jusqu’à leurs moindres histoires !