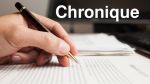Le sens d’une initiative présidentielle

Par Mansour M’henni
Loin des tiraillements politiques où sont emballés la plupart des partis politiques et même certaines organisations nationales professionnelles,
dans la foulée des débats parlementaires et de la médiatisation des auditions publiques de victimes « politiques » du passé, j’ai été particulièrement sensible à un événement culturel initié par le Président de la République et consistant en une « une exposition phare, avec des chefs d’œuvres tunisiens et des prêts rares internationaux, dédiée aux partages religieux en Méditerranée ».
Lieux saints partagés est le nom de cette exposition dont une première version a été présentée en 2015 à Marseille ; elle est le produit d’un partenariat entre l’Institut National du Patrimoine, le Musée National du Bardo et le Musée national des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem). L’intention première et la motivation profonde de cet événement est de s’inscrire dans une culture du vivre-ensemble portée par la conscience et le devoir de partage. En ce temps où l’on s’entredéchire au nom de la précellence d’une religion, n’importe laquelle, par rapport aux autres, toutes les autres, n’est-ce pas une heureuse entreprise que de remette en mémoire le patrimoine partagé des trois religions qui ont fondé la Méditerranée en tant que berceau de la civilisation humaine ?
C’est que, de fait, les guerres de religions semblent avoir inculqué à l’esprit humain la conviction que seule la violence est à même de conclure les conflits et que l’Autre est d’abord un ennemi avant de pouvoir se réduire à un partenaire docile, toujours à titre provisoire, en attendant une autre redistribution des rapports interactifs, mesurés à l’aune du rapport des forces. Cet état d’esprit a ainsi proliféré en ghettos culturels et en cloisonnements civilisationnels finissant en un monde d’éternels conflits. Les valeurs elles-mêmes, telle celle de tolérance, paraissent ne plus valoir qu’en tant que mots nourrissant la rhétorique du pouvoir et la démagogie des idéologies.
Rien qu’à vouloir redresser ce cheminement intellectuel et éthique (et c’est en principe l’essence et l’essentiel d’une politique culturelle vraiment démocratique), l’initiative présidentielle fait effet d’un éveilleur de conscience, peut-être comme Socrate a su le faire dans un contexte historique (serait-il semblable au nôtre) où la démocratie manquait sa cible et sa mission pour se transformer en un instrument de la dictature. C’est en cela qu’on retrouve l’intelligence et l’action culturelles au centre de tout projet de société humaniste : humaine trop humaine ? Humaine rien qu’humaine !
Ce qui m’interpelle encore plus dans l’initiative présidentielle, c’est son esprit de méditerranéité ; celle-ci, ayant été un concept en éclosion au milieu des années 90 du siècle dernier, a fini enterrée dans les tiroirs suspects de certaines idéologies lugubres d’un prétendu « printemps arabe ». Pourtant, l’idée de printemps aurait pu réussir avec l’esprit de méditerranéité qui est d’essence conversationnelle même si, à la pratique, la conversation y a été souvent en défaut. Mais on a sans doute encore en mémoire l’attitude de certains de nos députés « postrévolutionnaires » qui, bénéficiant d’une majorité accidentelle, se sont opposés à l’inscription de la méditerranéité de la Tunisie dans une nouvelle constitution en élaboration par l’ANC.
Faire redémarrer la construction de la méditerranéité est une des initiatives les plus utiles aujourd’hui et des plus nobles, pouvant modérer la fougue de certains extrémismes et d’attitudes passionnées par l’égocentrisme et le rejet de l’Autre. Le faire par le biais de la culture dote ce projet d’une condition fondamentale de sa réussite et d’une plus-value essentielle pour sa crédibilité et sa visibilité.
C’est dans ce cheminement qu’à l’occasion, on ne peut que vivement saluer l’annonce de la « Déclaration de Tunis contre le terrorisme, pour la tolérance et la solidarité entre les peuples, les cultures et les religions », un texte qu’il faut prendre à la fois comme une déclaration d’intention, comme un serment d’engagement et comme un programme de travail. Et à partir de là, espérer que cette fois se réalise l’heureux mariage entre l’éthique humaniste et la pratique politique.